Dans sa visite au Burundi au cours du mi-avril 2025, Albert G.Zeufack, directeur des opérations dans 4 pays africains au sein de la Banque Mondiale, à savoir : Le Burundi, l’Angola , la RDC, et Sao Tomé Principe a accordé une interview à Burundi Eco sur la collaboration entre son institution et le pays. Il parle de la manière de gérer les projets, comment faire face à la pénurie du carburant et des devises, de gestion de la dette publique, de l’appui budgétaire…

Albert G.Zeufack, directeur des opérations à la Banque Mondiale pour la République Démocratique du Congo, l’Angola, le Burundi, le Sao Tomé et Principe.
1.Comment évaluez-vous la collaboration actuelle entre la Banque Mondiale et l’administration burundaise dans la mise en œuvre des projets financés par votre institution ? Quels sont, selon vous, les principaux défis rencontrés et quelles perspectives envisagez-vous pour renforcer cette coopération à l’avenir ?
R : Albert G.Zeufack, Directeur des Operations
Nous avons une très bonne collaboration avec le Gouvernement du Burundi et en sommes très heureux. La vocation de la Banque Mondiale est d’éradiquer la pauvreté sur une planète vivable. Cet objectif s’aligne parfaitement avec les priorités du gouvernement du Burundi telles que définies dans le Plan National de Développement. Nous partageons ainsi une vision stratégique commune avec le gouvernement.
Cependant, cette collaboration s’inscrit dans le temps. Il y a trois ans, par exemple, nous faisions face à d’importantes difficultés au niveau du portefeuille des projets, notamment au sein des unités de gestion. Depuis lors, des efforts considérables ont été déployés, entraînant des progrès notables. L’année dernière, le taux de décaissement du portefeuille du pays figurait parmi les plus élevés de la région Afrique. Ce qui constitue une réelle source de satisfaction. Cela témoigne le travail acharné et l’engagement fort du gouvernement burundais qui assure la mise en œuvre des projets avec l’appui de la Banque Mondiale.
Il convient également de souligner l’existence des groupes de travail sectoriels mis en place avec le gouvernement. Ces groupes se réunissent régulièrement pour discuter avec les spécialistes de la Banque des principaux obstacles identifiés dans le portefeuille des projets. Ils formulent des recommandations concrètes afin d’accélérer leur mise en œuvre. Nous avons aussi instauré une revue à mi-parcours, un outil essentiel pour identifier les problèmes et rechercher ensemble des solutions adaptées.
Néanmoins, la situation macroéconomique actuelle du pays constitue un défi de taille. Trouver des solutions à des problématiques complexes telles que la réforme du taux de change, l’augmentation persistante de l’inflation, la stabilité de la gestion financière, la politique budgétaire, le déficit ou encore la dette publique, demeure particulièrement difficile. Malgré cela, nous poursuivons notre travail avec le gouvernement afin de parvenir à des solutions durables.
Il y a trois ans, l’une des principales difficultés freinant l’exécution rapide des projets résidait dans le manque de compétences dans des domaines transversaux de gestion des projets tels que la passation des marchés ou encore les sauvegardes sociales et environnementales. Ce qui entraînait des retards significatifs. Nous avions constaté un manque de personnel bien formé dans ces domaines. Aujourd’hui, en partenariat avec le gouvernement, nous avons lancé une initiative ambitieuse visant à former massivement des Burundais à ces nouveaux métiers. Cette collaboration permettra, dans un avenir très proche, de former des centaines de professionnels, contribuant ainsi à accélérer la mise en œuvre des projets financés par la Banque Mondiale ou par le pays même.
2.Face aux défis économiques actuels tels que la pénurie de carburant et la rareté des devises, quelles stratégies la Banque Mondiale recommande-t-elle pour atténuer ces déséquilibres ? Quelle est la nature de son appui pour aider le Burundi à inverser cette tendance ?
R : La Banque Mondiale (BM) est là pour accompagner le gouvernement. Elle n’impose rien à aucun pays. Elle a pour mission d’apporter un soutien technique et financier à la mise en œuvre des programmes et projets du gouvernement. La BM n’a pas vocation de se substituer aux gouvernements : elle se limite à un rôle de conseil.
En ce qui concerne la réforme du régime de change, la rareté des devises et l’inflation, bref, tous ces problèmes macroéconomiques, ce sont des questions complexes, qui ne sont pas propres au Burundi. De nombreux pays africains sont confrontés aux mêmes difficultés. Pour sortir de cette crise, il est nécessaire de mettre en œuvre, de manière concomitante, cinq types de réformes.
Premièrement, il faut s’attaquer clairement à la réforme du régime de change, afin de réduire l’écart entre le taux officiel et le taux du marché parallèle. Il est indispensable de prendre des mesures précises pour réduire cet écart, car il constitue une distorsion qui profite à certains agents économiques ou à des individus qui ne participent pas à l’activité productive. Plus cet écart est important, plus il devient facile d’acheter des devises, notamment des dollars, pour les revendre au marché parallèle et en tirer un profit, plutôt que d’investir dans l’économie réelle. C’est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour corriger cette situation. A ce titre, la Banque centrale dispose de tout un arsenal d’instruments pour y parvenir.
Deuxièmement, un ensemble de réformes fiscales et budgétaires doit être mis en œuvre en parallèle. Il s’agit de veiller à ce que les recettes publiques soient mobilisées et dépensées de manière rigoureuse, afin d’éviter la création des déficits. En effet, si les problèmes de change sont réglés, mais qu’on continue à générer d’importants déficits publics, cela aura toujours un impact négatif sur le taux de change. Le financement monétaire de ces déficits risque d’aggraver l’inflation et de déstabiliser la monnaie. Une bonne gestion des finances publiques est donc essentielle.
Troisièmement, la réforme doit concerner la politique monétaire. Il est inutile d’unifier les taux de change si, dans le même temps, on continue à recourir à la planche à billets, c’est-à-dire à l’émission excessive de monnaie. Une telle pratique empêche toute stabilisation durable du cadre macroéconomique.
Quatrièmement, il faut agir du côté de l’offre, en augmentant les exportations du pays. Sans exportations, il est impossible de générer des devises. A défaut, on se contente de gérer le peu de devises disponibles, alors qu’il serait plus judicieux d’élargir la base en stimulant les exportations. Le secteur minier, en particulier, offre une opportunité majeure d’augmenter durablement les exportations du Burundi. Des efforts sont à fournir dans ce domaine, et nous savons que le gouvernement est déjà à pied d’œuvre.
Enfin, cinquièmement, il est fondamental d’améliorer la gouvernance. Cela passe par une transparence accrue dans la gestion des finances publiques, des marchés publics et du secteur minier, entre autres. La réussite des réformes macroéconomiques en dépend largement. Le numérique, en tant qu’outil puissant de bonne gouvernance, peut être un levier déterminant. La BM partage cette vision : elle appuie déjà le gouvernement et finance le projet numérique, sans oublier l’importance du renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion financière, de passation des marchés et de sélection des investissements.
3.La dette publique du Burundi connait une hausse importante depuis 2015. Quelles en sont, selon la Banque Mondiale, les conséquences à moyen et long terme, notamment pour les générations futures ? Quelles pistes de solution ou orientations pourraient être envisagées pour contenir cette dynamique ?
R : De nombreux pays s’endettent pour financer leur développement… Le problème n’est pas le niveau d’endettement en soi, mais plutôt la qualité de cet endettement, c’est-à-dire l’usage qui est fait de la dette
Cela signifie que l’endettement doit servir à l’investissement et non à la consommation. Les investissements réalisés grâce à la dette doivent être choisis de manière absolument rationnelle et objective dans une perspective de développement durable du pays. Ils doivent être guidés par des choix politiques clairs et fondés sur leur capacité à accroître non seulement le Produit Intérieur Brut (PIB), mais aussi à générer des emplois et à réduire la pauvreté.
S’endetter pour construire des infrastructures, créer un environnement propice au développement du secteur privé, établir des partenariats public-privé ou soutenir la création d’emplois peut avoir un impact positif et durable. En revanche, s’endetter pour financer des dépenses courantes constitue un véritable problème.
C’est pourquoi la question essentielle n’est pas tant le taux d’endettement que la qualité de la dette et l’usage qui en est fait. Cela dit, si le ratio d’endettement approche ou dépasse 70 % du PIB, cela devient un signal d’alerte. A ce stade, il est légitime de s’interroger sur la soutenabilité de la dette.
La soutenabilité de la dette est primordiale : elle signifie que le pays est en mesure d’en assurer le service, c’est-à-dire de rembourser le principal et les intérêts, sans compromettre ses finances futures.
Un autre aspect de la qualité de la dette concerne les conditions d’emprunt. La dette est-elle concessionnelle ou non ? A quel taux d’intérêt le pays s’endette-t-il ? Il existe des dettes dites « usuraires », dont les conditions sont si défavorables qu’il devient difficile, voire impossible, de les rembourser sans que cela pèse lourdement sur les finances publiques. Dans ce cas, une grande partie des recettes fiscales est absorbée par le service de la dette, au détriment des dépenses sociales ou productives.
Il est donc crucial de rester vigilant sur les termes de l’endettement. Un pays comme le Burundi devrait éviter autant que possible de contracter des emprunts non concessionnels, c’est-à-dire sans conditions préférentielles, notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt.
En ce qui concerne la Banque Mondiale (BM), elle ne contribue pas au problème de la dette car l’enveloppe dédiée au Burundi est constituée à 100 % de dons. Lorsqu’un pays négocie des emprunts, le gouvernement doit s’assurer que ces prêts sont non seulement concessionnels, mais qu’ils sont également destinés à financer des investissements capables, à terme, de générer les ressources nécessaires au remboursement de la dette.
La bonne gestion de la dette publique repose sur au moins quatre éléments essentiels:
- Premièrement, une meilleure gestion des dépenses publiques afin d’améliorer l’efficacité de l’investissement. Il est nécessaire de mieux cibler les investissements, de les évaluer rigoureusement en amont, puis d’assurer un suivi-évaluation systématique.
- Deuxièmement, il faut accroître la mobilisation des ressources domestiques, c’est-à-dire renforcer la capacité du pays à se financer par ses propres moyens, plutôt que de dépendre de la dette extérieure, souvent plus coûteuse. L’Office Burundais des Recettes (OBR) joue déjà un rôle important à cet égard. Il est essentiel de mobiliser les recettes fiscales pour financer son propre développement. Dans un contexte où l’aide au développement tend à diminuer, les gouvernements doivent davantage compter sur leurs propres ressources pour prendre en charge les services essentiels, tels que l’éducation et la santé. Cette situation représente une opportunité pour l’Afrique : celle de se responsabiliser davantage et de cesser de dépendre systématiquement des autres.
- Troisièmement, les partenariats public-privé (PPP) constituent un levier important, notamment dans le domaine des infrastructures. L’Etat n’est plus obligé de financer intégralement ces projets sur son propre budget. Il peut plutôt offrir des garanties au secteur privé pour l’inciter à investir. Toutefois, cela nécessite de négocier des contrats de PPP de qualité. Mal négociés, ces contrats peuvent devenir un fardeau pour le pays. C’est pourquoi il est crucial de disposer de toute l’expertise nécessaire lors des négociations. Dans ce domaine, il n’y a pas d’amis, il n’y a que des intérêts.
- Enfin, la transparence des données est fondamentale. Sur les marchés de la dette, il suffit que les investisseurs perçoivent un manque de transparence pour que le risque pays augmente. Ce qui renchérit le coût de l’endettement. A la Banque Mondiale, nos recherches ont montré que plus les pays publient leurs données de manière transparente, plus le coût de leur dette diminue. A l’inverse, un pays qui ne communique pas ses données financières se pénalise lui-même.
4.La Banque Mondiale envisage-t-elle d’apporter un appui budgétaire direct au Burundi dans un avenir proche ? Si oui, à quel horizon pourrait-on raisonnablement s’attendre à ce soutien, et sous quelles conditions ?
L’appui budgétaire est l’un des outils utilisés par la Banque Mondiale. Il s’agit d’un soutien financier direct accordé au budget de l’Etat. En parallèle, nous suivons également avec le gouvernement les projets d’investissement financés et mis en œuvre par celui-ci.
Cependant, l’appui budgétaire comporte des restrictions importantes. Etant donné qu’il s’agit de ressources versées directement au budget national, et que ces ressources sont fongibles, nous nous accordons avec le gouvernement pour que certaines réformes soient mises en œuvre avant tout décaissement.
L’une des conditions les plus importantes est que le cadre macroéconomique soit adéquat et stable. En effet, sans stabilité macroéconomique, l’appui budgétaire risque de ne pas atteindre ses objectifs.
Il y a deux ans, nous avons entamé des discussions avec le gouvernement. Depuis, d’importants progrès ont été réalisés. Nous pensons que la plupart des réformes nécessaires sont en cours de finalisation. Dès que le cadre macroéconomique sera jugé satisfaisant, nous pourrons envisager de reprendre les discussions sur l’appui budgétaire.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement afin de garantir la mise en œuvre de sa vision et de son programme de développement. Notre présence est constante, et le portefeuille de la Banque Mondiale pour le pays a considérablement augmenté, passant d’environ 200 millions USD il y a dix ans à 1,9 milliard USD aujourd’hui. Ce chiffre représente la taille totale des engagements.
Nous devons désormais accélérer la mise en œuvre des projets afin que ces engagements se traduisent concrètement en investissements. Cela signifie que les conditions de décaissement doivent être mises en place rapidement pour permettre les investissements nécessaires.
L’objectif est que les populations burundaises ressentent les effets de ces investissements dans leur vie quotidienne, notamment en matière d’accès à l’électricité, à l’éducation, à la santé, à la nutrition, aux infrastructures, à la prévention des catastrophes naturelles et à la protection des populations vulnérables, par exemple à travers des projets de transferts sociaux comme Merankabandi.
5.Dans une perspective de développement durable et de renforcement de la crédibilité du pays auprès des partenaires techniques et financiers, quels conseils clés la Banque Mondiale pourrait-elle formuler à l’intention des décideurs burundais ?
R : Lorsqu’il s’agit de la crédibilité, nous la définissons de manière simple : faites-vous ce que vous avez dit que vous alliez faire ? Cela suppose d’abord que les intentions soient clairement exprimées.
Dans le cas du Burundi, les choses sont claires. Il existe un Plan National de Développement, une vision « Burundi émergent en 2040, et développé en 2060 ». Le PND identifie 18 priorités. Il ne reste plus qu’à les mettre en œuvre.
La vraie question est donc : comment s’organise-t-on pour concrétiser cette vision ? C’est cela, la crédibilité.
Nous travaillons aux côtés du gouvernement pour nous assurer que là où notre appui est nécessaire, nous sommes présents pour accompagner les efforts du gouvernement.
Le Burundi traverse une période difficile comme beaucoup d’autres pays en Afrique. Mais la Banque Mondiale reste un partenaire fiable, prêt à aider. Si nous unissons nos efforts pour mettre en œuvre cette vision claire, alors le Burundi a toutes les capacités pour se développer.


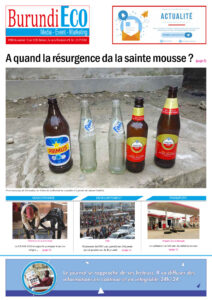

















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.