En décembre 2019, un virus inconnu de la famille des coronavirus est apparu dans le centre de la Chine. Les autorités du géant asiatique prennent rapidement des mesures drastiques de confinement et de désinfection pour près de 60 millions de personnes. Cependant, le virus, comparable à celui de la grippe espagnole, se répand partout dans le monde. Il paralysa des pays entiers, suscita la psychose et ébranlant l’économie mondiale. Burundi Eco va essayer de vous expliquer le déroulé des événements qui ont conduit cette épidémie à devenir une urgence internationale
Le 31 décembre 2019, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté sur plusieurs cas de pneumonie dans la ville de Wuhan (Province de Hubei en Chine). Mais ce virus ne ressemblait à aucun virus connu. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un nouveau virus de la famille des coronavirus. Dans un premier temps il a été baptisé temporairement « 2019-nCoV » puis définitivement Covid-19 ou SARS-CoV-2. Certains pays ont minimisé l’importance et la gravité de cette épidémie. La chine était un peu lointaine, s’auraient-ils dit. Sauf que passés quelques jours, ce virus sera le plus pire cauchemar de l’année qui venait de s’annoncer dans le monde entier.
Tout est parti si vite…
Tout commence fin décembre 2019. Une rumeur circule dans le monde des scientifiques qu’une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonies dites atypiques, peut-être virales. Huit médecins tentent de donner l’alerte, mais ils ont été réduits au silence. L’un d’eux décèdera de la pneumonie le 7 février 2020. Jusque-là le virus incriminé n’est pas connu. Le 30 décembre 2019, seuls quelques scientifiques sont au courant. La Chine aurait informé l’OMS discrètement d’un début de l’épidémie. L’épidémie parte de Wuhan, une ville du centre du pays qui compte plus de 11 millions d’habitants.

Depuis l’apparition du Covid-19, on estime à plus ou moins 4 milliards les personnes confinées chez eux.
Et tout aurait commencé dans un marché de fruits de mer. Ce qu’il faut savoir c’est que dans ce marché il y a des animaux vivants qui sont vendus illégalement pour être mangés comme par exemple les rats, les serpents ou même les chauves-souris et sont souvent entreposés à côté des autres aliments. Et pour de nombreux chercheurs chinois, le réservoir pourrait également être la chauve-souris. Début février, une équipe de chercheurs chinois de l’université d’agriculture du Sud de la Chine a estimé que le chaînon manquant pourrait être le pangolin, un petit mammifère à écailles en voie d’extinction. Mais la prudence est de mise en attendant une confirmation définitive.
Depuis janvier, le marché de Wuhan est désinfecté et fermé. Même si les rumeurs circulent, la population n’est pas toujours au courant d’une potentielle épidémie de coronavirus. Le 7 janvier, les autorités chinoises annoncent à l’OMS que c’est un nouveau coronavirus. Le 11 janvier, la télé d’Etat annonce un premier mort. Le nouveau coronavirus commence à se propager. Ce virus se transmet d’homme à homme. Le 22 janvier, on est à 23 jours depuis la dernière alerte, l’OMS se veut toujours rassurante. Le directeur général de l’OMS adressait des louanges à la Chine quant à la gestion de la crise : « Ce que la Chine est en train de faire c’est de prendre des mesures très, très forte avec une implication totale », disait-il. Le 23 janvier, la ville de Wuhan est mise en quarantaine.
Le 26 janvier, l’OMS change radicalement de discours. « Le risque au niveau régional est élevé et pour la Chine très élevé », estime Christian Lindmeier, porte-parole de l’OMS. La crise chinoise est désormais devenue une crise mondiale. La quasi-totalité du globe est frappée par la pandémie de Covid-19.
De l’épidémie à la pandémie
Depuis l’apparition du nouveau coronavirus fin décembre 2019, le bilan du coronavirus ne cesse de s’alourdir avec plus de 1,4 million de cas confirmés et plus de 89 000 décès dans 184 pays et territoires selon un bilan établi par les chercheurs du Centre pour la Science et l’Ingénierie des Systèmes (CSSE) de l’Université Johns Hopkins de Baltimore. 337.074 autres ont guéri (les statistiques du 9 avril 2020 ).
Foyer originel de la pandémie, la Chine sans compter les territoires de Hong Kong et Macao -dénombre 82.883 cas. Un nombre désormais en très faible augmentation de jour en jour, poussant certains à s’interroger sur la véracité des chiffres donnés. Le pays est aujourd’hui largement dépassé par les Etats-Unis (432.438 cas), l’Espagne (152.446 cas) et l’Italie (139.422 cas). Arrivent ensuite l’Allemagne (113.296 cas), la France (83.080 cas), l’Iran (64.586) et le Royaume-Uni (61.487).
Qu’est-ce que le Covid-19 ?
Les coronavirus qui doivent leur nom à la forme de couronne qu’ont les protéines qui les enrobent font partie d’une vaste famille de virus dont certains infectent différents animaux, d’autres l’homme. Deux épidémies mortelles sont déjà survenues au 21ème siècle impliquant des coronavirus émergents hébergés par des animaux et soudain transmis à l’homme. D’abord on a connu le SRAS-CoV (2002-2003) ou coronavirus à l’origine d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) apparu en Chine. Plus de 8 000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées (soit près de 10% de mortalité). Ensuite le MERS-CoV (2012-2013) ou coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Il est ainsi appelé, car il a été détecté pour la première fois en Arabie Saoudite. 1 589 cas et 567 décès dans 26 pays ont été enregistrés (soit un taux de mortalité d’environ 30%). La troisième épidémie mortelle est celle liée au SARS-CoV-2 ou Covid-19 apparu en Chine en décembre 2019. Les premiers cas recensés sont des personnes qui se sont rendues sur un marché local, à Wuhan, dans la province de Hubei. Sur le plan virologique, le SARS-CoV-2 est très proche du SRAS-CoV. C’est pourquoi il a été placé dans la même espèce de coronavirus (suivi du chiffre 2 pour le distinguer du précédent).
Attention, si vous présentez ces symptômes !
Les symptômes les plus courants du virus sont une forte fièvre (supérieure à 37,5°C) et une toux sèche ou grasse. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, d’une sensation d’oppression ou d’essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë. Moins fréquents, la perte brutale de l’odorat et la perte du goût peuvent également présager de la maladie. Dans les cas plus graves, l’infection peut en effet provoquer « une détresse respiratoire , une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multiviscérale pouvant entraîner la mort », disent les scientifiques. Les difficultés respiratoires peuvent survenir après quelques jours de maladie et ce alors même que les premiers symptômes étaient bénins. La maladie reste bénigne dans 80 % des cas ; elle est grave dans environ 15% des cas et critique dans 5% des cas. Les chercheurs estiment que le taux global de mortalité du virus est d’environ de 2 à 4%, avec des disparités selon les pays
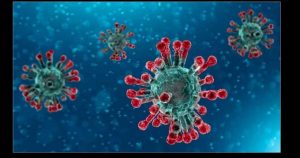
La forme de couronne qu’ont les protéines qui enrobent ce virus lui doit le nom de « Coronavirus »
A la recherche du vaccin
De la France à la Chine, de l’Australie aux Etats Unis, les laboratoires du monde entier sont à l’œuvre pour trouver un vaccin. Les équipes de chercheurs avancent sur l’élaboration d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, mais toutes sont unanimes : il va falloir plusieurs mois pour le mettre au point. Il ne permettra donc pas d’enrayer l’épidémie de coronavirus actuelle. En effet, il ne suffit pas seulement de trouver la bonne formule, le vaccin doit ensuite être testé sur les animaux, puis sur les humains et ce, à chaque étape de son processus de fabrication. Au total, il faut compter entre 6 et 36 mois pour la production, le conditionnement et la livraison auprès des différents pays concernés qui vont à leur tour effectuer des contrôles de qualité. Pour qu’un vaccin soit sûr, il faut une longue période de vérification.
La guerre de la chloroquine
En tout cas, l’histoire retiendra le nom du Dr Didier Raoult dans la course au traitement contre le Covid-19. Il y en a qui font beaucoup parler de lui : le Plaquenil, un antipaludéen dérivé de la chloroquine… La chloroquine, un médicament utilisé depuis plus de 70 ans pour traiter le paludisme et les maladies rhumatismales. Raoult défie le business des industries pharmaceutiques au moment où une véritable course contre la montre est lancée pour trouver un vaccin qui, certes, va sauver une bonne partie de la population, mais qui va coûter un pognon de dingue, contrairement à la chloroquine déjà disponible dans des millions de pharmacies dans le monde, notamment en Afrique. Les Etats prendront avec précaution ces recherches dans un premier temps. Cependant, certains finiront par être séduits par l’idée du Dr Raoult. Présentement, le médicament est à l’essai et n’a pas encore été homologué par l’OMS comme médicament de prédilection pour traiter le Covid-19. Il appelle à la prudence. Pour l’OMS, le débat sur l’efficacité de la chloroquine sera conclu quand «les essais cliniques seront terminés.
Les autres croient aux remèdes miracles, des tisanes faites à base de gingembre, de citron, j’en passe…Sauf que tous ces remèdes ne sont peut-être que du baume au cœur et non un traitement ni curatif ni préventif contre le Covid-19, du moins selon les propos des scientifiques.
Aujourd’hui, on estime à environ 4 milliards de personnes qui sont confinées de chez eux. Les frontières des pays sont fermés, les usines sont fermées, les transports terrestres maritimes, ferroviaires, et aériens sont réduits au strict minimum ou n’existent plus. C’est le monde entier qui est chambardé. Comme disait quelqu’un : « les Chinois ont mangé la mauvaise viande mais c’est le monde entier qui se lave les mains », sauf qu’il y a un autre courant qui dit que ce virus est un « made man ». Qui saura ?




















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.