Depuis février 1991, le Burundi célèbre la fête de l’Unité nationale. Cette cérémonie perd de vitalité au fil des années en dépit des engagements forts énoncés dans la Charte de l’Unité des Barundi. A travers cette Charte, les Barundi aspiraient à la paix et à la tranquillité. Ils étaient plus que jamais déterminés à bâtir une société fondée sur l’unité de tous les citoyens dans l’intime conviction que celle-ci constitue la pierre angulaire de l’édification nationale. Mais qu’en est-il réellement de ce patrimoine en péril. Analyse.
Par Clovis IRIHO
La gouvernance à l’épreuve de l’unité
Dès l’aube de l’indépendance, l’histoire du Burundi est caractérisée par des incidents qui ont déchiré le tissu social qui unissait les burundais. Le choc le plus retentissant fut l’abolition de la monarchie en 1966, rendant la société plus vulnérable à toutes les prétentions divisionnistes. En effet, le burundais étaient unis autour d’un roi, garant de l’unité du royaume. Le coup de force qui a déposé le roi a désacralisé tout ce qu’il incarnait, l’unité de la population comme sa fonction. Très tôt, le pays s’est plongé dans une crise d’incessants conflits identitaires, parfois les plus sanglants comme ceux de 1972 et 1993. Les massacres de l’année 1972, orchestrés par le régime en place envers sa propre population, ont témoigné davantage le fossé qui séparait les dirigeants et le sens de l’unité.

La détérioration de l’unité et du sentiment de vivre ensemble n’a pas seulement mis à l’épreuve le destin du peuple, mais aussi l’exercice du pouvoir. Très tôt après l’indépendance, les régimes se sont succédés au rythme des coups d’Etat, qui ne garantissaient pas toujours le bien-être de la population. Si le régime de 1966-1976 a commis des atrocités qui ont emporté des milliers de vies, celui de 1976-1977 n’a pas pris l’initiative de les corriger. Au contraire, ce dernier a renforcé les clivages identitaires et régionalistes, rendant tous les progrès économiques vains, quant à leur durabilité. Il sera à son tour, comme il est venu, évincé par un coup d’Etat au mois de juillet 1987.
Un défi de l’histoire récente
Après seulement une année, le nouveau régime de 1987 a été mise à l’épreuve par une tragédie de Ntega-Marangara, deux communes respectivement des provinces Kirundo et Ngozi au Nord du pays. Une nouvelle fois, le pays a été endeuillé par des massacres qui ont touché la population. Toutefois, cet incident ne s’est pas enflammé à l’extérieur de ces communes et n’a pas duré longtemps. Tout cela a contribué à la pérennisation du sentiment de méfiance entre les membres des communautés. Ainsi le nouveau pouvoir a été mise à l’épreuve de l’héritage de l’histoire récente et devrait trouver un moyen de tourner la page.
Comparativement aux deux régimes précédents, celui de 87 a manifesté de réelles intentions de trouver la solution au problème de l’unité des burundais. Si les autres ont exercé le pouvoir dans une tendances monopartite et que même le nouveau a pris le pouvoir dans le même contexte, il s’est montré ouvert à l’existence de plusieurs acteurs sur la scène politique burundaise. Cela a fait émerger une autre élite politique, dont ceux qui se sentaient opprimés au départ. Un autre élément qui a marqué ce pouvoir, ce sont ses efforts pour penser l’unité des burundais.
Après les conflits identitaires, les divisions de tout genre, le besoin de la restauration d’un climat de confiance était très grand. Après des sessions de consultations, le Burundi a abouti à l’adoption de la Charte de l’Unité Nationale le 05 février 1991. Consécutivement à cette Charte, un monument fut érigé, un hymne composé et enseigné, et enfin un drapeau mis sur le mat. La Charte de l’Unité Nationale est devenue même la partie intégrante de toutes les lois fondamentales qui ont suivi. Lors de prestation de serment, en plus de jurer fidélité à la Constitution, les prétendants aux postes constitutionnels doivent aussi s’engager à la fidélité envers la Charte de l’Unité Nationale. Tous ces éléments montrent que l’enjeu de l’unité a été mis au centre pour réunir les burundais pour un destin commun. Cependant, l’histoire et ses évènements qui ont suivi poussent à questionner si réellement l’intention de ces démarches autour de l’enjeu de l’unité était digne de foi.
L’unité à l’épreuve de l’histoire
L’héritage des deux dernières décennies a eu un grand impact dans la configuration du climat sociopolitique du régime de 87. Les efforts consentis montrent l’espoir de changer la tendance pour une nouvelle société unie et inclusive. A part la Charte en soi, l’hymne composé pour ce nouveau paradigme en parle beaucoup. Ce dernier glorifie l’Unité des burundais, l’arme et le bouclier de la nation et son développement. L’ouverture de l’espace politique aux acteurs revenu de l’exil était un facteur déterminant pour restaurer le sentiment du vivre ensemble entre les différentes couches de la population.
Le début de la décennie 90 a été prometteur sur tous les plans en matière de la gouvernance inclusive. Les burundais ont célébré leur Charte, plusieurs partis politiques sont nés, les premières élections démocratiques sont organisées en 1993. De ces élections, le Président en exercice a été vaincu et le transfert du pouvoir s’est fait dans un climat pacifique. Tous ces évènements attestaient le début d’une nouvelle ère au niveau du vivre ensemble. Cependant, après seulement trois mois, le Président élu a été assassiné par des militaires mutins, mais qui n’ont pas pris le pouvoir après le coup.
Résurgence des conflits identitaires
A cette époque, la grande muette avait été politisée par des régimes militaires successifs, l’amenant même à orchestrer des actes sectaires. L’endoctrinement que certains groupes sociaux avaient reçu continuait à affecter la cohabitation au sein des communautés, et à inspirer certaines actions, y compris les atteintes à la vie d’autrui. Si les massacres de masse perpétrés dans le passé ont fait des victimes, parfois dans le silence, l’assassinat du Président va plonger le pays dans une guerre civile qui va durer douze ans. Cela aura aussi plusieurs conséquences comme la violence de masse dans tout le pays, la naissance et la prolifération des groupes armés, et bien d’autres.
La société a été complétement déchiré, l’être humain burundais a été dénaturé et les valeurs qui faisaient l’esprit de l’unité nationale ont été oubliées. Ces évènements ont mis à l’épreuve le concept en soi et de tous les éléments constitutifs de l’unité nationale.
 L’unité nationale à l’épreuve du temps
L’unité nationale à l’épreuve du temps
Malgré les questions qui se posent autour du concept, tous les pouvoirs qui se sont succédés reconnaissent que c’est un enjeu pertinent pour bâtir une société prospère. En effet, le jour du 05 février de chaque année est férié, marquant la commémoration l’adoption de la précieuse Charte de l’Unité Nationale. Cela prouve que tout le monde accorde une grande importance à l’unité et la cohésion sociale, ce que les burundais ont perdu pendant plusieurs années après l’indépendance.
Aujourd’hui, le concept de l’unité, tout comme celui de la cohésion sociale est assez complexe. Elle implique les relations à la fois verticales et horizontales. Dans le sens horizontal, elle implique la nature des interactions entre les individus qui partagent une même communauté. Et au sens vertical, elle appelle les relations que les individus entretiennent avec leur communauté en général, la fierté d’appartenir à une nation. Toutes ces relations vont être nourries par toute une série de facteurs endogènes et exogènes. L’unité nationale est pensée à partir des réalités auxquelles les individus font face au sein de leur communauté. En d’autres termes, l’unité des burundais s’articule autour des facteurs socioculturels, économiques et politiques. La cohésion est parfaite au moment où chaque membre de la communauté trouve le sens du bien-être par rapport à tous ces facteurs. Le cas contraire, c’est la frustration relative, la méfiance et le sens d’abandon.
Ne pas tirer les leçons du passé
« L’histoire nous apprend que l’homme n’apprend rien de l’histoire », disait le philosophe allemand Hegel. L’histoire du Burundi d’après l’indépendance nous montre des échecs qui n’ont pas permis de bâtir une cohésion parfaite. Cependant, ce sont les mêmes échecs qui se sont succédés jusque dans les décennies les plus récentes. Or, nous étions appelés à apprendre des erreurs de nos prédécesseurs pour ne pas tomber dans le même piège. La Charte de l’Unité Nationale et l’hymne y relatif sont des textes fascinants qui peuvent nous aider à repenser notre unité en tant que nation. Si chaque année nous célébrons en vertu de ces textes, il est très important de refaire une lecture approfondie et réfléchie, qui nous permettra de dépasser les erreurs du passé et établir une vision commune sur le long terme.
Contrairement à plusieurs pays d’Afrique, et même du monde, le Burundi dispose d’un tas d’atouts qui peuvent garantir la cohésion sociale. Il existe peu de pays où toute la population parle une seule langue sur toute l’étendue du territoire. Le peuple burundais partage également une même culture, un même territoire ainsi qu’une même histoire. La liste n’étant pas exhaustive, tous ces éléments forment un fondement sur lequel nous pouvons bâtir une société unie, disposée à défendre l’intérêt commun pour une communauté durable. Le Burundi a connu des conflits internes, mais c’est encore possible de redresser la situation. Le troisième verset de l’hymne de l’Unité nationale est assez pertinent à ce propos et la mise en avant de cette conception du vivre ensemble nous permettra d’aller au-delà des clivages qui ont déchiré le tissu social.
Et le chercheur Clovis Iriho de rappeler : « Ubuzima ni katihabwa, Ntitubuhahaze, Urwanko, ntirwubaka, Turwanye amacakubiri, Dutuze na Ba gateranya, Tuzokwubahiriza zina muntu, Dusenyere ku mugozi umwe, Dusangire ikivi N’ikigega ». A bon entendeur salut !

 L’unité nationale à l’épreuve du temps
L’unité nationale à l’épreuve du temps











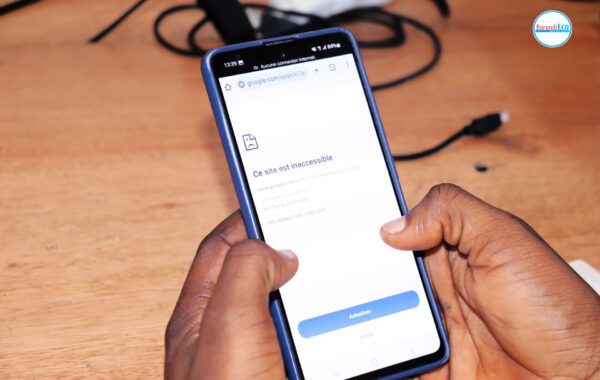









Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.