La dette publique, extérieure et intérieure, frôlera en 2025 près de 7 000 milliards de FBu, soit une redevabilité de plus de 500 000 FBu par citoyen. Un chiffre impressionnant, mais pas forcément alarmant, car le pays ne figure pas parmi les plus endettés du monde. Contracter une dette n’est pas une malédiction en soi, car bien orientée, elle peut contribuer au développement.

« S’endetter n’est pas le vrai défi. Le problème, c’est l’affectation de la dette. Il faut savoir utiliser les fonds empruntés à bon escient ».
« Il est rare qu’un Etat parvienne à couvrir toutes ses dépenses sans recourir à l’endettement », explique Hugues Nkengurutse, ancien journaliste passionné par les questions économiques.
Il s’exprimait lors d’un atelier organisé par l’Initiative Citoyenne pour l’Environnement et le Développement Durable (ICED), dans le cadre de son plaidoyer pour la justice économique et la promotion du civisme fiscal. L’événement, destiné aux médias, s’est tenu jeudi le 24 avril 2025 à Bujumbura autour du thème : « La crise de la dette africaine : quel agenda politique pour le Burundi ? »
L’atelier visait à interpeller les candidats aux différentes élections de 2025 et les médias sur l’urgence d’intégrer la gestion de la dette publique et la mobilisation des ressources internes dans les programmes électoraux.
Pour M. Nkengurutse, il est évident que plus un Etat est puissant, plus il est souvent endetté.
« La dette n’est pas forcément une mauvaise chose, surtout lorsqu’elle intervient dans la satisfaction des besoins des citoyens. Ce qui compte c’est la gouvernance qui suit. Il faut éviter le gaspillage des fonds empruntés et maintenir une bonne crédibilité auprès des bailleurs de fonds », insiste-t-il.
Au nom d’African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD), Theophilius Jong ajoute que la coordination des politiques d’endettement au sein des communautés économiques régionales pourrait renforcer la protection des intérêts des Etats africains.
Qui paie la dette ?
« C’est nous, nos enfants, nos petits-enfants… », déclare M. Nkengurutse.
Il note que la dette intérieure représente plus de 70 % de la dette publique du Burundi, car le pays recourt à l’autofinancement.
Etienne Ndikumana, directeur de la dette publique et de la trésorerie au ministère en charge des finances, abonde dans le même sens :
« Le problème n’est pas dans le fait de s’endetter, mais dans l’affectation des montants empruntés. Il faut que la dette génère des ressources capables de couvrir les échéances ». M.Ndikumana souligne que de nombreux pays se sont enrichis en s’endettant intelligemment.
Stany Ngendakumana, directeur de la communication et des services aux contribuables, et porte-parole de l’Office Burundais des Recettes (OBR), rappelle que le remboursement interpelle tout un chacun.
« Même bien utilisée, la dette pèse sur chaque citoyen. Il est donc essentiel de sensibiliser sur son usage et ses enjeux. Le défi majeur reste la collecte efficace des recettes et leur affectation dans l’intérêt du public », insiste-t-il.
Un impact direct sur l’accès aux marchés internationaux
Selon l’Hon. Jean Bosco Muhungu, le Burundi n’est pas éligible au marché des capitaux internationaux. Ce qui le contraint à s’endetter à l’interne.
« Quand la Banque Mondiale (BM) ou le FMI arrivent dans un pays, ils évaluent sa capacité de remboursement. Si un pays est classé en zone rouge, il est considéré à haut risque et devient inéligible à des prêts », notifie-t-il.
Dans ce cas, la Banque centrale émet des bons, des certificats et des obligations du Trésor, proposés aux banques commerciales.
« Celles-ci préfèrent prêter à l’Etat. Celui-ci est perçu comme un client stable. Ce qui pénalise le secteur privé, moteur de la croissance économique », déplore Hon.Muhungu avant d’aviser que quand un pays est mal noté par la BM et le FMI, les taux d’intérêt flambent ».
Il ajoute que le Burundi étant un pays receveur de dons, les bailleurs exigent des garanties assurées souvent par des compagnies d’assurance étrangères.
« Ces institutions évaluent les risques, imposent des primes, et limitent les montants prêtés. Elles délèguent parfois le recouvrement à des tiers, à condition que le pays accepte de payer des commissions », reconnait-il.
Agnès Gahwahi, retraitée des finances, n’est pas du même avis. « Si l’Etat est perçu comme non crédible et qu’on lui prête malgré tout de l’argent, à des taux spéculatifs, cela n’est-il pas condamnable juridiquement ? », s’interroge-t-elle.
A cela, l’Hon. Muhungu rétorque que les lois nationales perdent leur force à l’étranger. Une fois en négociation sur les marchés internationaux, la souveraineté juridique s’amenuise.
Pour Appolinaire Nishirimbere, président de l’ICED, il est temps de démocratiser la dette. Il est plus facile de contracter une dette que de mobiliser les recettes internes. Pourtant, ce processus devrait être citoyen. Il faut impliquer les parlementaires.


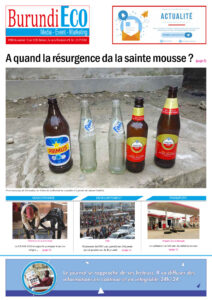

















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.