L’une des fiertés du Burundi est qu’il abrite la source la plus méridionale de l’un des longs fleuves du monde : le Nil. Une artère vitale pour l’Afrique de l’Est et les 10 pays qu’il traverse et qui fait vivre des millions de peuples riverains. Cependant, ce fleuve alimente de vives tensions entre le pays des Pharaons (Egypte) et le Tigre africain (l’Ethiopie)
Le Nil, un fleuve mythique, un enjeu économique, diplomatique, alimentaire, agricole… qui dépasse largement les intérêts individuels de chaque pays riverain. Mais le Nil, c’est aussi un partage des eaux qui est longtemps resté figé dans le poids de l’histoire. La question des eaux du Nil est restée pendant longtemps une prérogative de l’Egypte. La civilisation égyptienne s’est largement développée grâce à lui et autour de lui, notamment en ce qui concerne l’agriculture et l’alimentation dans cette immense zone désertique. Et pendant longtemps et trop longtemps peut-être, l’Egypte a bénéficié des bienfaits du Nil sans vraiment se préoccuper de ce qui se passait en amont. Comme si le fleuve sacré jaillissait miraculeusement de l’intérieur des frontières du pays pour fertiliser ses terres et abreuver sa population. Mais ça, c’était avant…
En 2011, l’Ethiopie a rendu public un projet préfigurant la construction du plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique doté d’une capacité de production électrique de 6500 mégawatts baptisé par les éthiopiens « Barrage de la Renaissance ». Le projet est estimé à 4 USD et devrait être opérationnel en 2022. La guerre du Nil est déclarée.

L’Ethiopie veut remplir le réservoir du barrage le plus vite possible. Ce que refusent les Egyptiens qui craignent une forte baisse de leurs ressources en eau pendant toute la durée du remplissage, car 95% de l’eau consommée en Egypte vient du Nil.
L’Egypte, le gâté de l’histoire
En 1959, lorsque les Britanniques quittent l’Egypte et le Soudan, un accord répartit entre les deux pays la gestion des eaux du Nil : l’Egypte aura le droit d’en prélever 66% et le Soudan 22%, le reste étant considéré comme perdu par évaporation. Cet accord fondateur s’inscrit dans la droite ligne d’un premier accord signé en 1929 et qui donne à l’Egypte de droit de regard exclusif sur le fleuve. Le pays se voyait attribuer un droit de véto sur toute construction en amont susceptible de réduire le débit de l’eau : barrage, station de pompage, grands travaux d’irrigation, etc…
Et, ce qui est frappant, c’est que ces deux traités (celui de 1929 et celui de 1959) semblent ignorer les autres pays traversés par le fleuve. Car, si le Nil termine effectivement sa course en Egypte avant de se jeter dans la mer Méditerranée, avant cela il traverse et alimente en eau une dizaine de pays en Afrique de l’Est : Soudan, Soudan du Sud, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, RDC, Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Et la plupart de ces pays sont soumis aux mêmes pressions que l’Egypte : même climat, même forte poussée démographique, mêmes besoins en termes de développement économique. Ils pourraient donc pour la plupart légitimement souhaiter une répartition plus équitable des eaux du Nil.
Si la question est restée longtemps en léthargie, c’est le projet de haut barrage d’Assouan, en Egypte dont la 1ère pierre est posée en 1948 qui va mettre le feu aux poudres, notamment en Ethiopie.
La répartition des eaux du Nil
En 1999, plusieurs pays riverains du Nil décident de se regrouper pour discuter de la répartition historique des eaux du Nil, la fameuse «Initiative du Bassin du Nil». Pour l’heure, l’Egypte intègre le groupe.
En mai 2010, après 10 ans de discussions, l’Ethiopie, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda rejoints ensuite par le Kenya et le Burundi signent un accord qui autorise les pays situés en amont du fleuve à développer des projets d’irrigation ou des barrages. Et ce, sans demander l’autorisation de l’Egypte qui se retire alors de l’Initiative du Bassin du Nil mais ne peut pas empêcher l’accord d’entrer en vigueur.
Barrage de la Renaissance sur le Nil : vives tensions entre l’Ethiopie et l’Egypte https://t.co/nRdegqLaQE
— FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 16, 2020
Le rôle central de l’Ethiopie
Pour comprendre le rôle central de l’Ethiopie, il faut remonter à la source ou plutôt aux sources du Nil, car le fleuve est multiple et ses deux branches principales se rejoignent à Khartoum au Soudan. La branche la plus longue, celle qu’on appelle communément « le Nil Blanc » est composée de plusieurs affluents dont la source la plus lointaine remonte jusqu’au Burundi.
L’autre branche, « le Nil bleu » prend naissance au sud de Tana en Ethiopie. Cette branche, plus courte que l’autre contribue pourtant à la majorité du débit du fleuve.
Le barrage de discorde
Une fois le Barrage de la Renaissance achevé, il va falloir le remplir de 79 milliards de m3 d’eau. Et là encore, les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres : les Ethiopiens voudraient le remplir le plus vite possible. Ce que refusent les Egyptiens qui craignent une forte baisse de leurs ressources en eau pendant toute la durée du remplissage, car 95% de l’eau consommée en Egypte vient du Nil.
Une réduction de son débit pénaliserait son agriculture, lui ferait perdre des emplois, réduirait ses ressources. L’Egypte souhaiterait une durée de remplissage de près de 15ans au moment où l’Ethiopie table sur une durée de 4 à 7 ans. L’Egypte accuse l’Ethiopie de se comporter en pouvoir hégémonique en refusant de se soumettre à un engagement sur un passage d’un volume minimum d’eau en cas de sécheresse sévère. L’Egypte craint d’être frappée par l’insécurité alimentaire.
Si en 2015, l’heure semble être plutôt à la réconciliation, en 2019, le ton monte de nouveau entre l’Egypte et l’Ethiopie. Les deux pays se menacent mutuellement de déclencher une guerre. Les négociations menées sous l’égide des Etats-Unis ont échouées. Le dossier est ensuite porté devant par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Signalons à toutes fins utiles que la présidente de l’Ethiopie a visité le Burundi du 09 au 10 février 2021. Selon les dires, la question autour des eaux du Nil serait parmi les sujets qui ont alimenté l’entretien qu’elle a eu avec son homologue burundais. L’Ethiopie aurait-elle besoin d’un soutien de la part du Burundi ?


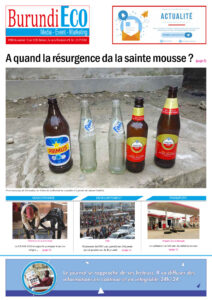

















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.