La lutte pour les droits de l’enfant ne date pas d‘aujourd’hui. Elle a une histoire, un long parcours. Certes, il y a des avancées, mais les défis persistent. Profitant de cette semaine dédiée aux droits de l’enfant célébrée le 20 novembre de chaque année, Burundi Eco retrace l’historique de la Convention relative aux droits des enfants et rappelle les engagements des gouvernements
C’est au tournant du XXè siècle que la lutte pour les droits de l’enfant est amorcée. Le chemin sera long. Dans un monde secoué par de multiples conflits et toujours habité par un esprit d’esclavage et ouu prolifere une philosophie communiste accusée de ne pas respecter les droits de l’homme, il était courant que les enfants travaillent aux côtés des adultes et parfois dans des conditions extrêmement difficiles et dangereuses pour leur santé. Il aura fallu de longues années de lutte pour une adoption qu’une Convention sur les droits de l’enfant soit adoptée par les Nations Unies.
En 1924, la Société des Nations Unies a adopté la Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant. La conquête des droits de l’enfant ne faisait que commencer. Rédigée par Eglantyne Jebb, philanthrope britannique fondatrice de Save Children Fund, la déclaration stipule que toutes les nations ont le devoir de respecter les droits de l’enfant à disposer des moyens nécessaires à son développement, à bénéficier d’une aide spéciale en cas de besoin et à être le premier à être secouru, à bénéficier de la protection contre l’exploitation et d’une éducation.

Dans un grand nombre de régions, de pays et de communautés, les enfants les plus pauvres et les plus marginalisés sont laissés pour compte.
En 1946, la création de l’Unicef par l’Assemblée générale des Nations Unies ajoutera une autre brique à la tour qui se construisait. Dans un monde secoué par des conflits armés, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflits armés le 14 septembre 1974.
En 1987, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) abolira le travail des enfants de moins 18 ans. Désormais, tout travail susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’une personne ne pourra être accompli par un enfant. C’est enfin en 1989 que la Convention relative aux droits de l’enfant est adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette action fut connue comme une réalisation importante de l’ONU en matière des droits de l’homme.
Une convention qui met les gouvernements devant leurs responsabilités
Cette convention revêt un aspect universel. Il suffit de passer en revue certains articles du document pour comprendre sa portée. Les Etats-parties s’engagent à respecter la convention dans son entièreté. Les articles de la convention sont clairs. Le premier article de ce document stipule que toute personne âgée de moins de 18 ans est un enfant et doit donc bénéficier d’une protection spéciale de son entourage et de son Etat. Dans son caractère universel, la convention sur les droits de l’enfant appelle chaque Etat à respecter les droits de tout enfant indépendamment de son origine, de son état physique ou mental. « Aucun enfant ne doit être traité injustement pour quelque raison que ce soit », souligne la convention en son article 2.
Les gouvernements sont mis devant leurs responsabilités. Comme indiqué à l’article 4 de la convention, ces derniers sont invités à tout faire pour que les enfants résidant au pays ou ceux de passage profitent de tous les droits prescrits dans cette convention. Dans le même ordre d’idées, le 6ème article insiste sur le fait que «chaque enfant a le droit de vivre. Chaque gouvernement doit s’assurer que les enfants survivent et s’épanouissent le mieux possible». Toute forme d’exploitation et de maltraitance des enfants est interdite par la convention et ils doivent être protégés en cas de guerre ou de conflits armés.
Les défis persistent malgré des avancées notables
Malgré que la majorité des Etats soient signataires de cette convention qui reste le fer de lance de la protection de l’enfant, les droits de l’enfant restent menacés dans le monde actuel. Dans son rapport de 2019 sur les droits de l’enfant dans le monde, l’Unicef affirme: «L’adoption de la convention relative aux droits de l’enfant il y a 30 ans a globalement permis la réalisation des progrès historiques en faveur des enfants de moins de 18 ans dans la quasi-totalité des aspects touchant à leurs droits et à leur vie». Selon les observations de l’Unicef, la Convention a également changé le regard que porte le monde sur les enfants désormais considérés comme détenteurs de droits.
Cependant, cette agence des Nations Unies chargé de veiller sur les droits de l’enfant fait remarquer que les défis à relever restent énormes. «Bien que nous soyons parvenus à une ratification presqu’universelle de la Convention relative aux droits de l’enfant, les droits de millions d’enfants ne sont toujours pas respectés», déplore le rapport. Dans un grand nombre de régions, de pays et de communautés, les enfants les plus pauvres et les plus marginalisés sont laissés pour compte.
Fin 2019, Amnisty international, une organisation de défense des droits de l’homme indique que certains droits de l’enfant sont menacés plus que d’autres, notamment, en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la santé. Le travail des enfants, la malnutrition et l’extrême pauvreté restent les menaces les plus étendues au monde.



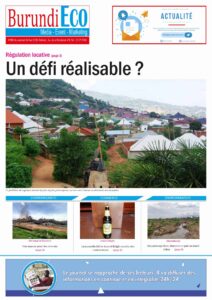

















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.