L’agriculture va de pair avec la conservation et la préservation du sol par la lutte antiérosive et l’amélioration de la qualité du sol. Et l’élevage a toujours été le complément de l’agriculture pour la correction du sol grâce au fumier qu’il procure. Les familles rurales sont appelées à élever des animaux domestiques à des fins agricoles
Les facteurs à la base de la croissance agricole sont entre autres le sol, l’eau, les différents capitaux (financiers, humains…) et le capital biologique (animal et végétal). Cela a été dit par Pr. Salvator Kaboneka, enseignant à l’Université du Burundi dans la Faculté d’Agronomie et de Bio-Ingénierie (FABI) à travers l’exposé qu’il a présenté lors du forum national sur le développement du Burundi qui a tenu ses assises à Bujumbura du 18 au 19 novembre 2021. Pour accroître et améliorer la production agricole, cet universitaire préconise une bonne gestion du sol en commençant par la structuration de l’espace rural. Dans le monde rural, s’observent des exploitations agricoles dispersées ou atomisées. Pour ce faire, l’agriculteur met toutes les cultures ensemble (cultures associées) à cause de l’exiguïté des terres. Cela est un indicateur qui montre que le Burundi a dépassé le seuil de la viabilité économique.

Lors du forum national sur le développement du Burundi, les stratégies d’accroissement et de l’amélioration de la production agricole ont été développées.
Les alternatives ne manquent pas
Pour y remédier, le remembrement, la mise en commun ou la gestion communautaire des terres au niveau familial, zonal, etc., peuvent constituer une alternative. La villagisation est également susceptible de libérer des terres agricoles. Par exemple, le fait de mettre la population le long des routes libère des espaces agricoles. Raison pour laquelle une cartographie de l’aptitude des terres est nécessaire dans le but d’assurer la spécialisation régionale de certaines cultures, pourquoi pas de l’agriculture du terroir.
Pour Dr. Séverin Nijimbere, doyen de la FABI, la gestion du sol est le point d’entrée pour améliorer la production agricole. Les sols burundais sont classés en deux groupes. Les sols des montagnes (Kirimiro, Bututsi, Buyenzi, Bugesera, Mugamba…) sont pauvres en éléments nutritifs, mais ils résistent à l’érosion. Par contre, le sol des Mirwa est moins profond et très vulnérable à l’érosion. Leur faiblesse consiste en leur acidité. Ce qu’on peut corriger avec le chaulage. Par ailleurs, le Burundi dispose de gisements de chaux qui peuvent servir l’agriculture jusqu’à 500 ans. Dans ces régions, la fertilité du sol est essentiellement assurée par les matières organiques comme le fumier. Ce qui améliore par ailleurs l’efficacité des engrais chimiques. Une autre catégorie de sol est celle de la plaine de l’Imbo. C’est une région fertile, mais qui est parfois salinisée (Gihanga, Cibitoke). Malheureusement, elle est menacée par l’urbanisation.
Gestion de l’eau et de l’élevage pour des fins agricoles
Selon Pr. Kaboneka, le Burundi regorge de beaucoup d’eau. Il est suffisamment arrosé à hauteur d’au moins 1200 mm/an. Les grandes rivières et les plaines irrigables y sont à gogo. Tout cela constitue le potentiel pour l’agriculture. Pour en profiter, la mise en place des réseaux d’irrigation-drainage est nécessaire dans les régions de l’Imbo, de Bugesera, du Moso et dans différents marais. Il faut aussi un système de collecte et de valorisation des eaux de pluie pour s’adapter aux changement climatiques.
Au-delà du sol et de l’eau, le fumier est à la base de l’amélioration de la production agricole et joue un rôle non négligeable dans la correction de l’acidité et de la toxicité du sol. Pour y arriver, il faut que l’élevage de subsistance mute vers l’élevage moderne. Cela est possible quand la stabulation permanente va de pair avec des mesures d’accompagnement comme la mise en place des centres naisseurs décentralisés à travers tout le pays. Leur intérêt vise la spécialisation régionale de l’élevage (gros bétail, petits ruminants, porc…) et la conservation ou l’amélioration génétique des races locales.
L’amélioration de la qualité des intrants agricoles et la mécanisation agricole sont une nécessité
Pour Pr. Kaboneka, la production des semences sélectionnées est un aspect non négligeable qu’il faut renforcer pour diversifier les variétés performantes et résistantes aux maladies et aux ravageurs. En plus de cela, les agriculteurs doivent avoir accès aux intrants agricoles de qualité. Toujours dans le but de soutenir l’agriculteur, l’Etat doit subventionner le secteur agropastoral, car cela est considéré comme un investissement à long terme. Cette subvention doit s’orienter particulièrement vers les jeunes diplômés qui se sont lancés dans l’agriculture en proposant des projets bancables. L’assurance agricole est également nécessaire.
Pour remplacer petit à petit l’utilisation de la houe, la mécanisation agricole à base des outils modernes comme les motoculteurs ou les tracteurs est nécessaire. Mais cette innovation va de pair avec les techniques de drainage et d’irrigation. Pour Damase Ntiranyibagira, un des panélistes, la mécanisation agricole a toujours été un problème au Burundi. A l’époque, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus, des projets de mécanisation agricole et un office de mécanisation agricole ont été mis en place. Il y a eu par ailleurs une note produite à cet effet. Il suggère qu’on réactive ladite note et qu’on la mette à jour pour la soumettre à qui de droit.



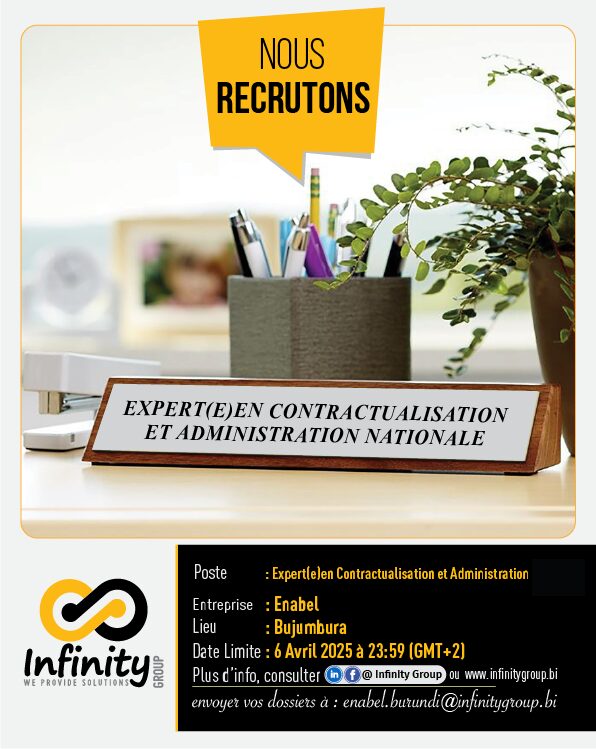

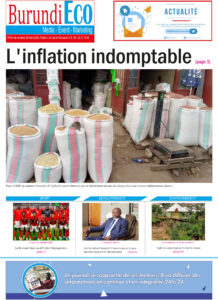


















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.