Le Réseau des Institutions de Microfinances (RIM) estime que le taux d’inclusion financière reste faible. Moins de 30% de la population adulte détiennent un compte dans les institutions financières. Il reste un long chemin à faire pour que les gens prennent l’habitude d’épargner. Les intervenants du secteur financier sont appelés à redoubler les efforts pour accroître l’inclusion financière

Bernard Kinyata, directeur général de Receca-Inkingi et président du conseil d’administration du RIM : «Il faut toujours avoir à l’esprit que le choix d’épargner ne dépend pas de l’importance des revenus disponibles»
Le 31 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée Internationale de l’Epargne. Cette journée a été célébrée au Burundi sur l’initiative du RIM en partenariat avec la Fondation Allemande des Caisses d’Epargne pour la Coopération Internationale (SBFIC). Le thème choisi était : « Epargnons pour demain ». La célébration de cette journée vise à inculquer la culture financière à la population Burundaise. Un accent particulier est mis sur l’importance et la nécessite de l’épargne formelle. Ainsi, avoir un compte dans une institution financière offre plusieurs avantages : la sécurité monétaire, l’identité financière qui permet d’accéder au crédit etc. « C’est une occasion pour sensibiliser les jeunes et les clients des microfinances sur l’importance de l’épargne », déclare M. Bernard Kinyata, directeur général de Receca-Inkingi et président du conseil d’administration du RIM.
Quelques indicateurs du secteur de la microfinance
|
Variables |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Clients et membres |
446 661 |
524 594 |
536 741 |
615 320 |
679 050 |
728 155 |
889 019 |
837 749 |
|
Montant des crédits octroyés en Fbu |
54 630 847 987 |
66 724 722 367 |
70 927 745 325 |
86 778 956 117 |
113 108 537 925 |
110 188 846 906 |
146 664 006 221 |
168 010 947 972 |
|
Nombre de crédits accordés |
136 413 |
144 032 |
154 988 |
178 126 |
168 460 |
126 729 |
104 623 |
109 590 |
|
Dépôts collectés en Fbu |
43 048 072 149 |
67 501 701 085 |
74 879 105 894 |
79 721 895 845 |
101 259 922 122 |
109 510 974 147 |
121 854 185 331 |
164 338 800 505 |
|
Nombre d’épargnants |
402 189 |
496 961 |
519 711 |
577 308 |
634 974 |
704 552 |
753 009 |
777 955 |
|
Encours crédits total |
56 308 664 246 |
86 010 520 188 |
67 044 509 891 |
82 833 701 817 |
107 523 682 979 |
113 604 390 613 |
140 854 185 332 |
183 461 228 395 |
|
Emprunteurs actifs |
127 398 |
144 446 |
143 541 |
168 456 |
204 599 |
200 638 |
221 016 |
252 556 |
|
Nombre de points de service |
190 |
277 |
277 |
314 |
321 |
316 |
337 |
349 |
|
Nombre d’employés |
1 025 |
1 134 |
1 188 |
1 342 |
1 501 |
1 553 |
1 638 |
1 713 |
L’importance de l’épargne
Pour Kinyata, l’épargne permet de rassembler les moyens pour réaliser un projet qu’on ne pourra pas réaliser avec les revenus ponctuels. Epargner c’est la meilleure façon de préparer son avenir. « Si aujourd’hui on a l’opportunité de gagner de l’argent ce ne sera pas toujours le cas toute la vie », prévient-il. L’épargne aide à faire face aux imprévus de la vie des individus et des familles (en cas de maladies, d’accidents et autres imprévus). Elle intervient également dans la scolarisation des enfants surtout dans le contexte de hausse des frais scolaires. Enfin l’épargne permet de réaliser des projets générateurs de revenus, car ces derniers nécessitent la mobilisation des ressources dans le temps.
L’épargne n’est pas synonyme de surplus de ressources
Bien que le niveau de revenus reste limité pour bon nombre de Burundais, il est toujours possible d’épargner. C’est une question de réalisme, car le fait d’avoir un revenu faible n’épargne pas la satisfaction des besoins sanitaires, vestimentaires ou alimentaires, estime M. Kinyata. Dans la vie de tout acteur économique, les ressources sont limitées tandis que les besoins sont illimités. Pour lui, la meilleure façon de financer les événements imprévus reste la constitution de l’épargne. Quel que soit le niveau de revenu, on peut tout dépenser. Il n’est donc pas possible de penser que l’épargne sera l’excédent de la consommation. Pour constituer une épargne, on doit décider la somme à épargner avant de dépenser, explique M.Kinyata. A titre illustratif, quelqu’un qui gagne 10 000 FBu peut décider d’épargner 1000 FBu pour les dépenses ultérieures. Et, au bout d’une certaine période, le petit montant épargné permettra de satisfaire un besoin non négligeable, précise-t-il.
D’après M. Kinyata, il faut toujours avoir à l’esprit que le choix d’épargner ne dépend pas de l’importance des revenus disponibles. Par contre, épargner c’est d’abord une décision personnelle ou familiale, car si on n’épargne pas on sera toujours en déficit par rapport aux ressources.
Un taux d’inclusion financière très faible
Malgré l’augmentation des IMFs (42 institutions de microfinance fonctionnelles jusqu’au 31 août 2018), le taux d’inclusion financière reste faible. Les statistiques de la Banque centrale estiment le taux d’inclusion financière à 21,4%. Cela implique que les besoins sont encore importants au niveau de la mobilisation de la population pour ouvrir les comptes dans les banques et autres institutions financières formelles.

Contribuer au développement du secteur de la microfinance, c’est contribuer au développement du pays (RIM)
Le président du conseil d’administration du RIM appelle les différents intervenants à conjuguer les efforts pour la réussite de l’inclusion financière. Ils doivent se mobiliser pour que les gens prennent l’habitude d’épargner et d’utiliser les comptes bancaires. Comme cela, ils pourront profiter des services offerts tant au niveau de l’épargne qu’au niveau des crédits.
M. Kinyata demande au gouvernement de mettre en place des mesures incitatives de promotion de l’épargne, entre autres mesures : la réduction des impositions et ses intérêts générés par l’épargne. Il reste confiant que c’est à travers la promotion de l’épargne que la population pourra effectivement développer le réflexe de garder les avoirs au niveau des institutions financières.
Pourquoi ce taux reste faible ?
Cette situation est imputable au retard du cadre légal. La première réglementation établie par la Banque centrale pour réguler les activités de microfinances date de 2006. Les initiatives privées qui se faisaient au niveau des institutions de microfinances avant cette date ne rentraient pas dans un cadre légal de suivi de l’autorité monétaire au niveau de ses activités. Ce qui occasionnait certains dérapages à l’origine d’une certaine réticence d’un bon nombre de clients. Le cadre légal et réglementaire a permis d’instaurer la confiance de plus en plus croissante du public vis-à-vis des IMFs
Les données reprises dans le tableau montrent que le nombre de clients et de dépôts dans les IMFs ne cessent d’augmenter et les dépôts dans les IMFs. En 2011, l’épargne qui était mobilisée au niveau des IMFs était de 67,5 milliards de FBu contre 109 milliards de FBu en 2015. Ceci prouve à suffisance que l’augmentation est sensible au niveau des activités des microfinances, constate M Kinyata.
Le projet PAIFAR-B ouvre de nouveaux horizons
Le Projet d’Appui à l’Inclusion Financière Agricole et Rurale du Burundi (PAIFAR-B) récemment lancé va booster le taux d’inclusion financière. Il cible surtout les producteurs agricoles (près de 100 000 ménages sont concernés). Pour Kinyata, le secteur de la microfinance attend beaucoup de ce projet étant donné qu’il vient pour booster la finance rurale. L’ensemble des institutions de microfinance constituent des acteurs qui sont présents à des niveaux décentralisés jusqu’au niveau collinaire. Ce qui signifie que l’un des partenaires importants de ce projet reste les IMFs qui vont travailler avec le projet PAIFAR-B pour augmenter le financement des projets agricoles et partant, créer des revenus, précise M. Kinyata. Le RIM s’apprête à collaborer avec le projet pour soutenir les ménages ruraux en termes d’accès au crédit, conclut-il.
A la question de savoir si le secteur des microfinances ne sera pas réticent vis-à-vis du financement agricole. Kinyata reconnait que les aléas climatiques font que les perturbations climatiques influencent négativement les récoltes, mais personne ne peut se passer de l’agriculture au Burundi comme ailleurs. « Les autres secteurs dépendent étroitement de l’agriculture. Etant donné l’importance de l’agriculture et face aux aléas qui persistent, tous les acteurs doivent conjuguer les efforts pour financer l’agriculture et partager les risques », suggère Kinyata. L’agriculture reste un secteur vital pour le pays et chacun des acteurs doit jouer son rôle pour maintenir le financement des activités agricoles. C’est un secteur dont on ne peut pas se passer, précise Kinyata.
L’organisation de la Journée Internationale de l’Epargne remonte à 1924 lors du premier congrès des Banques d’épargne à Milan en Italie. C’est le professeur Filippo Ravizza qui a déclaré le 31 octobre une journée dédiée à l’épargne. Au Burundi, cette journée a été célébrée pour la première fois en 2012, soit 88 ans après sa déclaration.



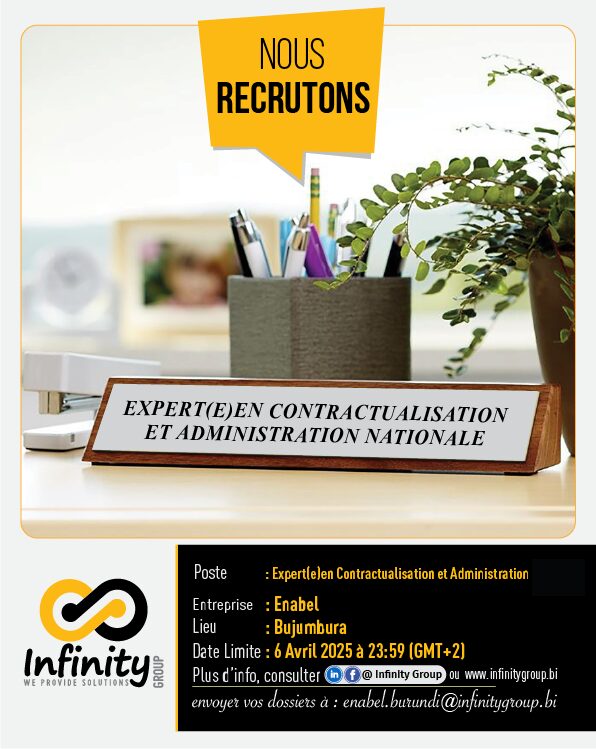

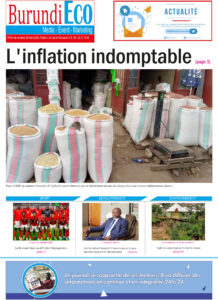


















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.