L’implantation de nouveaux campus universitaires à l’université du Burundi comme à l’Ecole Normale Supérieure d’ailleurs, prend en compte le désengorgement de la ville de Bujumbura, le rapprochement de l’enseignement supérieur de ses principaux bénéficiaires des milieux ruraux et l’introduction de nouvelles filières directement utiles au développement local. Les secteurs de production fussent-ils publics et privés ainsi que les Parents sont invités à soutenir cette politique du gouvernement

Quand l’université du Burundi a été fondée (1964), estime Gaspard Banyankimbona, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, imaginez-vous le nombre d’écoles secondaires qui existaient à cette époque-là. Il est possible qu’on retrouve actuellement ce même nombre d’écoles dans une seule province. « Depuis plus de deux décennies, il y a eu un une nouveau développement à l’enseignement supérieur avec l’émergence des universités privées qui se sont concentrées principalement dans la capitale Bujumbura où malheureusement le coût de la vie n’est plus à la portée des étudiants », indique le ministre avant d’ajouter que c’est une contrainte qui oblige le gouvernement à redessiner la cartographie de l’enseignement supérieur. Le ministère de tutelle estime qu’un regroupement des universités ou Campus Universitaires par pôles régionaux permettrait la couverture de grands ensembles régionaux. Ce qui constituerait un atout pour les institutions qui en profiterait pour mutualiser leurs ressources. M.Banyankimbona évoque la possibilité d’exploiter l’expérience du Sénégal en promouvant l’enseignement en ligne ou à distance en créant des campus/villages numériques décentralisés mais dépendant des campus centraux situées à Bujumbura. Selon lui, le potentiel de cette approche est énorme pour le Burundi au vu de la densité du réseau Back Bone System (BBS) et Viettel et les possibilités de connexion que ces derniers offrent. Il conseille cependant de rester réaliste et d’évoluer au rythme de la disponibilité des financements internes et externes.
Les campus périphériques s’intensifient
Hormis les campus opérationnels de Zege et du Centre Vétérinaire en province de Gitega, le campus Nyamugerera en province Bubanza, le campus de Mugara en province Rumonge, le campus Buhumuza est en perspective d’opérationnalisation en province de Cankuzo. Il est aussi envisagé la création d’un Institut Polytechnique à Cibitoke pour lequel on a déjà obtenu un prêt d’environ 12 millions USD du Fonds Saoudien. Cet institut pourra être opérationnel d’ici 2023. Avec ce prêt, le ministère envisage ouvrir deux filières innovantes qui correspondent aux besoins actuels et aux priorités du gouvernement. « On avait envisagé l’agro-business et la transformation agro-alimentaire, l’informatique à étendre à ses multiples applications, le génie-civil, surtout les qualifications très rares au Burundi comme les plombiers », rassure Gaspard Banyankimbona. Il dit être optimiste qu’avec la politique de décentralisation, on pourra aboutir à des résultats palpables. Tout le monde doit s’impliquer et doit comprendre qu’il ne s’agit pas de créer en cascade des Universités sans prendre en compte la considération de l’opportunité et le respect des normes, principalement celles de l’assurance qualité.
Il rappelle que le PND 2018-2027 intègre cet aspect de décentralisation et les projections d’ici 2027 d’avoir créé un Institut des Mines envisagé à Rutana, deux Instituts Supérieurs Professionnels à Muyinga et à Cankuzo et un Centre d’Excellence en Education Physique et Sportive à Karusi. Le Centre d’Excellence sous régional en Science de la Nutrition est, quant à lui, presque déjà acquis avec les promesses de financement de la Banque Africaine de Développement. Il sera établi au Centre Hospitalo -Universitaire de Kamenge et pourra, si tout se passe bien, être opérationnel en 2020.
Manque d’enseignants et ouverture d’autres campus
« Que dans un département, une faculté ou un Institut d’une université publique il y ait des professeurs à temps partiel, c’est très normal surtout pour les Instituts Professionnels comme l’Institut Supérieur de Commerce (ISCO). C’est un institut professionnel qui fait recourt à des académiciens, mais aussi à des professionnels qui sont ancrés dans le métier auquel il prépare ses étudiants », indique le ministre Banyankimbona. Selon lui, il ne faut pas considérer ce recours comme une sorte de faiblesse, mais plutôt comme une orientation vers la professionnalisation.
Et de poursuivre, si pour la comptabilité on doit amener un professeur à temps partiel, un comptable de carrière qui a 20 ans d’expérience en l’occurrence, c’est que c’est lui qui est mieux outillé d’enseigner dans ce genre de filière. On tend plutôt vers des formations hybrides où un étudiant pourra passer la moitié de son séjour à l’université dans un amphithéâtre et l’autre moitié dans une entreprise par exemple. A ce moment, il sera sous la responsabilité des professionnels et non pas directement des académiciens et sera prêt dès la sortie de l’université à exercer.
Contribution des coopérations interuniversitaires
Les enseignements sont renforcés par l’appartenance de nos universités à certains réseaux d’universités. Le ministre Banyankimbona évoque ici le Conseil Interuniversitaire de l’Afrique de l’Est auquel la plupart des universités du Burundi sont membres et le Forum des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture RUFORUM auquel l’Université du Burundi et l’université de Ngozi sont affiliées. Il cite aussi le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) et l’Association des Universités Africaines. Il informe qu’il y a beaucoup de conventions de partenariat qui sont signées ici et là par l’université du Burundi principalement avec les universités africaines (université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, Université d’Abomey Calavi, Université de Zambie, etc.), les universités européennes, les universités belges, les universités de la Chine, de la Russie, etc. Il y a beaucoup de programmes de mobilité. Que ce soit des programmes de l’Union Africaine, de l’Union Européenne, qui passent à travers ces réseaux d’universités ci-haut évoqués, précise-t-il avant de souligner qu’il y aura possibilité pour nos universités de concourir dans ces institutions pour obtenir des budgets pour les mobilités des professeurs.
Budget alloué à la recherche
La recherche en tant que telle n’est pas encore intégrée dans les pratiques des Burundais, déplore le ministre de tutelle. Le Plan National de Développement prévoit pour l’enseignement supérieur de renforcer l’expertise des centres de recherche et valoriser l’expertise locale. Pour lui, tous les budgets alloués aux différentes études et recherches dans différents ministères sectoriels sont à considérer comme des budgets entièrement alloués à la recherche et potentiellement disponibles pour les centres de recherche de l’Université du Burundi et d’autres Universités. On attend que la loi budgétaire soit disponible et que les institutions soient appelées à ventiler les budgets qui leur seront alloués. C’est à ce moment-là qu’on va enlever les dépenses obligatoires et ventiler le reste en mettant un accent particulier sur le financement progressif de la recherche. Il en appelle aux universitaires de s’ouvrir, aux chercheurs de sortir de leurs laboratoires et d’aller à la rencontre de la population en travaillant sur une problématique qui améliore ses conditions de vie et qui vont permettre de booster le développement du pays.

L’implication des secteurs de production sollicitée
Au cours de cette année, un forum Academia Private-Public partenership qui réunit le monde académique, les secteurs de production et les secteurs administratifs est envisagé par le ministère de l’Enseignement Supérieur. Selon le ministre Banyankimbona, une nouvelle approche de collaboration pour l’intérêt commun de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) sera abordée. Il voudrait qu’il y ait des implications du milieu professionnel, des industriels et des employeurs potentiels dans l’élaboration des offres de formation dans les universités pour qu’ils participent à la définition des profils à la sortie, et des profils qui répondent directement à leurs préoccupations. Il déplore que son ministère ne reçoive que des lamentations, mais non des propositions de la part des employeurs des lauréats de l’enseignement supérieur. Une enquête récente basée sur les besoins exprimés par certains ministères sectoriels en termes d’expertise à court, à moyen et à long terme prouve à suffisance un décalage entre les offres de formation actuellement disponibles dans les Institutions d’Enseignement Supérieur et les besoins exprimés. Une révision des offres de formation s’impose. Il devra y avoir une adaptation des plans stratégiques des universités pour s’aligner non seulement au PND 2018-2027, mais aussi aux Objectifs du Développement Durables de l’Agenda 2030, principalement l’ODD4.
Exploitation des TICs
« C’est vrai, il y a un problème au niveau des infrastructures, mais cela n’est pas une fatalité. Si nous n’avons pas assez de bibliothèques physiques, maintenant c’est l’heure de développer la bibliothèque numérique », indique le ministre Banyankimbona. Il informe que beaucoup d’universités se développent dans ce sens. Il tranquillise que son ministère est entrain de suivre le processus de création d’une bibliothèque virtuelle à l’Université du Burundi avec l’appui de ses partenaires nigériens. Cela n’est pas sans inquiétudes. Selon Banyankimbona, il se pose la question d’accès non seulement à la connexion internet, mais aussi aux terminaux informatiques par les étudiants. Il invite alors les parents ou toute autre personne physique ou morale, à contribuer encore davantage à la formation des enfants du Burundi, notamment en leur facilitant l’accès aux terminaux informatiques (ordinateurs ou tablettes) pour pouvoir accéder au contenu qui se numérise de plus en plus. L’accès au contenu physique étant de plus en plus limité, il explique que les smartphones dont disposent certains étudiants peuvent facilement se transformer en véritables outils de travail. Il invite les investisseurs potentiels à considérer cette situation comme une opportunité.
Brève histoire de l’université du Burundi jusqu’en 1989
C’est en 1958 que fut créée la faculté d’Agronomie de l’université du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Cette faculté a été transférée à Bujumbura en 1960 et intégrée en janvier 1964, en même temps que les facultés de Philosophie, Lettres et Sciences Economiques, à l’Université Officielle de Bujumbura (UOB). En 1965, l’Ecole Normale Supérieure a été créée avec pour mission de former les enseignants des écoles secondaires. En 1972, l’Ecole Nationale d’Administration fut créée en vue de former les fonctionnaires de l’Etat. C’est en 1973 que les trois institutions (UOB, ENS, et ENA) ont été fusionnées pour former l’université du Burundi. Cette fusion s’est effectuée progressivement. Au départ, l’ENA a été intégrée à la Faculté des Sciences Economiques et Administratives. C’est en 1977 que l’UOB et l’ENA ont été fusionnées totalement pour devenir l’université du Burundi.
Au début des années 1980, quatre autres institutions ont vu le jour, à savoir : l’Ecole de Journalisme, l’Institut Supérieur de Commerce et l’Institut Supérieur des Techniciens de l’Aménagement et de l’Urbanisme. En 1989, toutes ces institutions ont été intégrées à l’université du Burundi. Le principal objectif de cette intégration était de mieux utiliser les ressources allouées à l’enseignement supérieur.



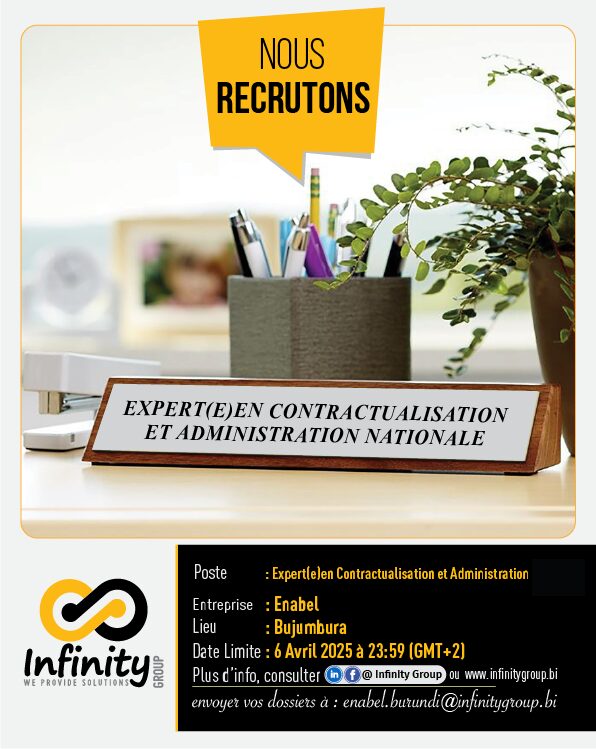

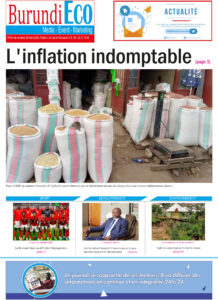


















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.