L’intégration dans la Communauté Est-Africaine (CEA) est inévitable et elle présente des avantages considérables. Amb. Jacques Ngendakumana, retraité ayant occupé plusieurs fonctions techniques et diplomatiques, conseille de développer l’industrie afin de tirer pleinement profit de cette intégration. Cela s’est exprimé à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de la création de cette communauté, le 30 novembre 2024

Amb. Jacques Ngendakumana : « Pour tirer pleinement profit de l’intégration dans la CEA, il faut que le pays soit industrialisé. »
« Le pays ne peut pas éviter d’intégrer la Communauté Est Africaine (CEA) vu sa situation géographique. Il se retrouve enclavé parmi les pays membres de cette communauté, où passe d’ailleurs la majorité de son commerce extérieur », explique Jacques Ngendakumana, un retraité septuagénaire. Diplômé en philosophie politique et en économie, spécialisé en monnaie et finances, il a occupé de nombreuses fonctions, à savoir : ambassadeur du Burundi en Ouganda, administrateur directeur général de la Banque Populaire, directeur général du budget et de la comptabilité publique, chef de cabinet, secrétaire permanent, coordinateur des réformes et cadre du partenariat avec les bailleurs de fonds au sein du ministère en charge des finances…
Cependant, il rappelle que le Burundi ne partage pas le même passé colonial avec les autres pays membres de la communauté.
Pour Amb. Ngendakumana, au-delà de l’appartenance à un marché élargi, l’adhésion à la CEA a apporté de nombreux avantages. Des banques solides et des compagnies d’assurance, comme KCB, CRDB, DTB et Jubilée Insurance, ont ouvert leurs portes dans le pays. « De grandes entreprises comme AZAM ont également vu le jour, créant ainsi des richesses et des opportunités », souligne-t-il.
Suppression des barrières non tarifaires
Amb. Ngendakumana a également salué la suppression des barrières non tarifaires au sein de la CEA. « Aujourd’hui, le temps que met un camion pour partir du port de Dar-es-Salaam (Tanzanie) ou du port de Mombasa (Kenya) pour arriver au Burundi a sensiblement diminué. Il roule comme s’il était à l’intérieur de son propre pays », se réjouit-il. Il poursuit : « Très récemment, des barrières non tarifaires ont été supprimées entre le Burundi et la RDC au niveau du tronçon Chanic-Gatumba frontière. Ce qui a un impact direct sur le commerce transfrontalier »
Outre la circulation des marchandises, la libre circulation des personnes est également facilitée, et il n’est plus nécessaire de détenir un visa. Toutefois, il déplore que les facilités pour le travail ne soient pas encore bien établies. Chaque pays cherche à protéger ses emplois. Malgré cela, il reste optimiste : « Comme les titres académiques ont été harmonisés, cela facilitera l’accès à l’emploi. »
Les Burundais privilégiés
Amb. Ngendakumana annonce que les Burundais bénéficient d’un avantage par rapport aux ressortissants des autres pays membres de la CEA. Ceux ayant suivi un cursus scolaire complet disposent de compétences solides en Français et en Anglais. « Lorsqu’ils chercheront un emploi dans des pays anglophones, ils n’auront pas besoin de formations linguistiques préalables », précise-t-il.
Il évoque également des Burundais, tels que des médecins, des informaticiens et des ingénieurs en construction, qui travaillent avec succès dans les autres pays membres de la CEA.
Industrialisation d’abord
Pour tirer pleinement profit de cette intégration, Amb. Ngendakumana recommande l’industrialisation du pays. Il regrette que l’agriculture soit encore principalement de subsistance et que les richesses minières ne soient pas transformées sur place. Selon lui, il serait crucial de vendre des produits finis, en encourageant les investisseurs.
Concernant le déficit énergétique, qui pourrait freiner l’essor des investisseurs, il reconnait que ce défi est en voie d’être résolu. « Le problème réside dans le réseau de distribution vétuste, qu’il faut renouveler ou remplacer par un nouveau réseau, en invitant les investisseurs à le financer », explique-t-il.
Quant à la pénurie des devises, Amb. Ngendakumana estime qu’il faut accepter certaines conditions, même contraignantes pour survivre en se soumettant aux bailleurs de fonds traditionnels afin qu’ils dégèlent les appuis. « Cela peut être fait discrètement pour redresser la situation. Si on ne le fait pas, les portes resteront fermées », affirme-t-il.
Le rêve d’un marché commun
Amb. Ngendakumana se souvient que le président ougandais Yoweri Museveni parlait d’un marché élargi pour stimuler les échanges, à l’image des États-Unis d’Amérique (USA). « Les USA n’ont pas besoin d’importer et se concentrent sur leur marché intérieur. Si nous sommes économiquement intégrés, même les conflits se résolvent plus facilement. Les citoyens peuvent se concentrer sur autre chose que la politique », rapporte-t-il.
Il rappelle que le traité créant la CEA a été signé le 30 novembre 1999 à Arusha en Tanzanie. Il est entré en vigueur le 7 juillet 2000, après sa ratification par les trois Etats fondateurs qui sont le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.
L’ancien haut fonctionnaire souligne que l’objectif principal de la création de la CEA était l’intégration économique qui aurait dû évoluer jusqu’à la création d’une monnaie unique. Cependant, les critères de convergence macroéconomique, notamment l’inflation, le déficit budgétaire, les réserves de change et le déficit de la balance des paiements, ne facilitent pas la création de cette monnaie. Il applaudit cependant l’utilisation des monnaies locales dans les pays membres de la CEA. Ce qui lui rappelle l’époque des années 1990, lorsque la Zone d’Echanges Préférentiels (ZEP) devenue le COMESA avait introduit une unité de compte pour le change.
Aujourd’hui, la CEA est passée de trois Etats fondateurs en 1999 à huit membres en 2024. Elle s’est élargie avec l’intégration du Burundi et du Rwanda (2007), du Soudan du Sud (2016), de la République Démocratique du Congo (2022) et de la République Fédérale de Somalie (2024).


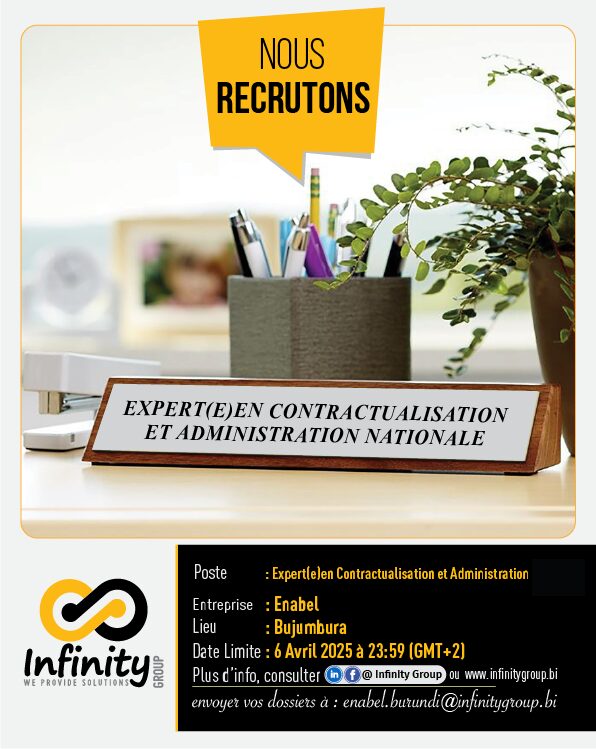

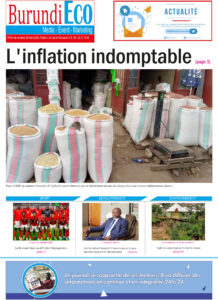


















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.