La plume peut-elle avoir une influence sur la perception de la femme dans la société ? La salonnière Jeanne d’Arc Nduwayo qui a animé le café littéraire organisé par l’Institut Français du Burundi (IFB) jeudi dernier est convaincue que l’image de la femme a évolué sous la plume des écrivains africains

La perception de la femme dans les œuvres littéraires a évolué. Il suffit de lire certains écrivains africains comme Mariama Bâ ou Callixthe Beyala pour se rendre compte que le rôle ou la place de la femme diffère d’un écrivain à l’autre. Même si ce sont des fictions, les romans ou d’autres œuvres littéraires reflètent la réalité de la société d’une certaine manière. Mais encore, les Saints Ecritures comme la Bible et le Coran sont des œuvres qui peuvent porter à confusion quand elles parlent de la femme.
« La littérature et la société sont intimement liées »
« Du fait que la littérature et la société sont deux mondes intimement liés, elles constituent en fait des sources où les auteurs puisent généralement leur inspiration, leur motivation. L’image de la femme sera différente suivant l’environnement où évolue l’auteur », a déclaré l’animatrice du café littéraire de jeudi dernier. On vient de le dire, les Saints Ecritures elles-mêmes portent une vision très équivoque de la femme, pense Mme Nduwayo. D’après elle, le statut que la Bible accorde à la femme la condamne à la soumission : « Le Seigneur Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » (Genèse 2.18). Ces éléments, de la société du point de vue religieux, influencent la plume sur la perception de l’image de la femme.
La tradition y est également pour quelque chose
Dans les sociétés africaines, en général, la polygamie a toujours existé. Elle est l’héritage d’une longue tradition tribale. Elle était et reste surtout pratiquée dans des mariages coutumiers. La civilisation occidentale, à travers la colonisation (mariage légale) et le christianisme, a initié le mariage monogamique. Mais toujours est-il qu’un écrivain puise dans le patrimoine traditionnel qui est le sien quand il fait son travail. Est-ce pour cette raison que Mariama Bâ, auteur sénégalaise née en 1929, orpheline de mère, qui a grandi sous l’éducation traditionnelle et pieuse de ses grands-parents, fait le portrait de la femme soumise dans son roman « Une si longue lettre» ? La salonnière n’est pas loin de cette idée. Elle a insisté sur le fait que la femme, dans ce roman de Mariama Bâ, est vue comme un objet. D’un côté objet de sa propre famille et de l’autre côté, objet de sa belle-famille. Cette vision traditionnaliste (préjudiciable peut-être) de la femme transparait aussi dans le roman du sénégalais Cheik Aliou Ndao, « Excellence, vos épouses ! » sous un aspect religieux.
La modernité a changé le regard de l’écrivain
L’écrivain d’aujourd’hui ne cantonne plus la femme dans son rôle traditionnel. Il lui donne un autre visage et d’autres horizons. Mme Nduwayo cite pour exemple l’écrivain Bernard Nanga, auteur du roman « Les chauves-souris ». Selon elle, cet auteur du monde moderne met en exergue l’image de la femme forte, qui ne se laisse pas manipulé par l’égoïsme des hommes qui croient qu’il suffit d’avoir des graines de maïs pour attraper les poules. Quant à la camerounaise Callixthe Beyala, elle va plus loin et parle de la femme rebelle, révoltée contre le système phallocratique dans son roman « C’est le soleil qui m’a brûlé »
La complémentarité, la solution
Si les écrivains peignent la femme sous divers aspects, parfois soumise ou carrément rebelle, l’animatrice plaide pour une complémentarité dans la relation homme-femme. Le féminisme qui est mis en exergue chez certains auteurs doit être compris en termes de droit. Le personnage de la femme ne doit ni être assimilé à la soumission ni être ancré dans la confrontation, encore moins dans la rébellion qui engendre la violence et ses cohortes de malheur.



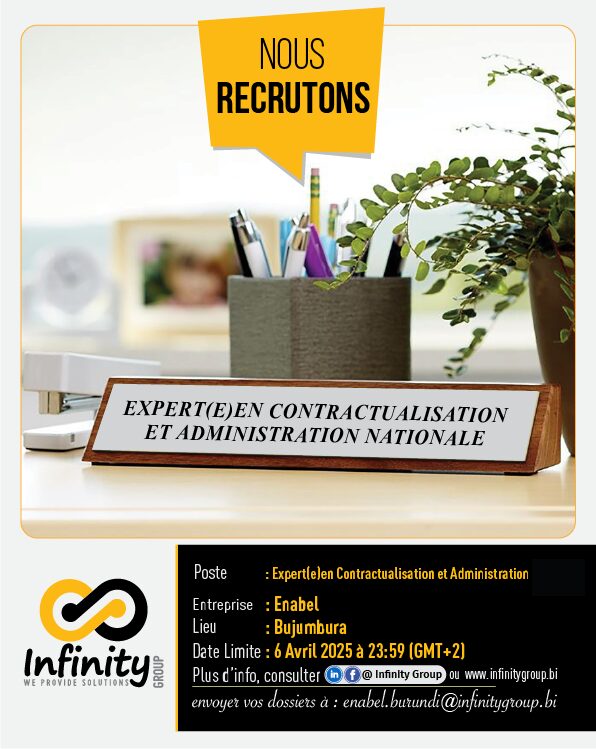

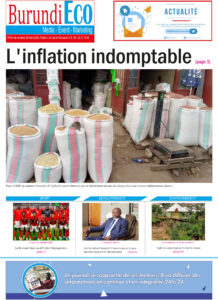


















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.