Dans une communauté, le favoritisme peut être une source de prolifération des messages de haine. Les victimes se sentent exclus et développent des frustrations qui sont à l’origine du manque de cohésion sociale. Pour Nicolas Hajayandi, professeur d’universités, les gestionnaires devraient gérer les ressources disponibles de manière impartiale en ne tenant pas compte d’autres critères comme l’appartenance sociale, politique…
Le favoritisme peut engendrer ou être une source de messages de haine dans la mesure où il divise, fait savoir Nicolas Hajayandi, professeur d’universités. « Il polarise en fait les personnes. Il y en a qui se sentent défavorisées alors que les autres sont favorisées ». Le Professeur Hajayandi explique que cela crée des divisions entre les personnes. De ces divisions peuvent découler des propos haineux tenus à l’endroit des auteurs du favoritisme et des bénéficiaires de ce favoritisme.

Nicolas Hajayandi, politologue : « Les victimes du favoritisme voient et vivent mal cette sorte d’injustice sociale ».
« Quand le favoritisme est pratiqué à grande échelle, les victimes développent des rancœurs. Elles sentent qu’elles sont exclues, qu’elles ne bénéficient pas de la même manière que les autres les avantages que procure la société, qu’elles ne profitent pas des conditions d’existence comme les autres. Là, les discours de haine peuvent s’ensuivre », montre-t-il.
Quelles autres conséquences ?
Le manque de cohésion sociale est aussi une autre conséquence du favoritisme. « Les victimes du favoritisme voient et vivent mal cette sorte d’injustice sociale ». Pour lui, la frustration relative qui s’installe est également une des conséquences qui peuvent s’ensuivre parce que les gens sentent qu’ils ne sont pas considérés de la même manière.
La meilleure des solutions serait d’éradiquer ce phénomène, explique Hajayandi. Néanmoins, cet expert trouve cela difficile parce qu’il y a insuffisance des conditions, des ressources matérielles. « Ceux qui sont chargés de les répartir le font en privilégiant certaines personnes au détriment des autres », ajoute-t-il.
Prof Hajayandi suggère que ces gestionnaires gèrent les ressources disponibles de manière impartiale en considérant les besoins des uns et des autres et en faisant fi d’autres critères comme l’appartenance sociale, politique… notamment en suivant des critères objectifs dans la répartition des ressources.



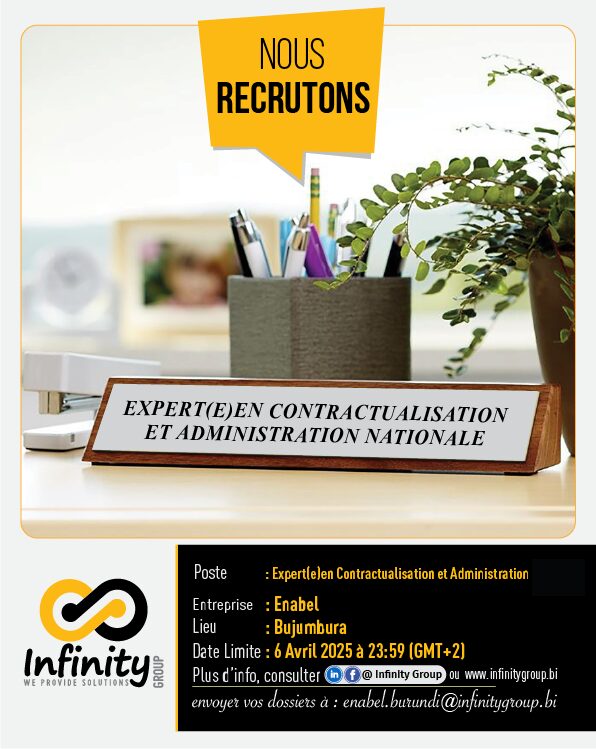

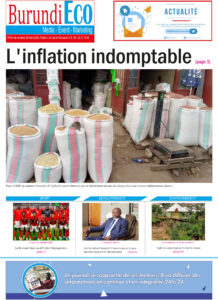


















Le contenu des commentaires ne doit pas contrevenir aux lois et réglementations en vigueur.
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les commentaires enfreignant ces règles et les règles de bonne conduite.